Dans ce registre peut-être plus encore que dans d’autres, les problématiques d’ordre sexuel peuvent avoir des origines très variées.
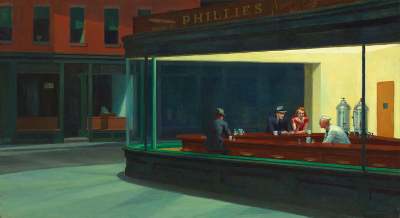 On sait par exemple que la sexualité est une fonction à la fois biologique et relationnelle.
On sait par exemple que la sexualité est une fonction à la fois biologique et relationnelle.
Ces deux dimensions étant très perturbées dans la dépression, il est logique que la vie sexuelle soit directement affectée lorsque l’on se trouve atteint de cette affection, notamment sous la forme d’une baisse de la libido. Elles peuvent également se greffer et s’alimenter sur des fragilités d’ordre psychologiques présentent en arrière-plan (précarité narcissique, conduites addictives, anxiété, manque d’estime de soi, cassures familiales…).
D’une façon plus générale des problématiques d’ordre psycho-affectif peuvent avoir une incidence majeure sur le plan de la sexualité d’un sujet. Qu’elles soient d’ordre conjoncturel (difficultés relationnelles dans le couple) ou plus ancrées (blessures d’enfance, carences affectives, deuils…), elles doivent pouvoir être articulées à la spécificité de chaque trouble, comme à la singularité de l’histoire de chaque sujet.
Plus encore peut-être que dans les affections précédentes, les problématiques d’ordre sexuel peuvent avoir des origines très variées. On sait par exemple que la sexualité est une fonction à la fois biologique et relationnelle. Ces deux dimensions étant très perturbées dans la dépression, il est logique que la vie sexuelle soit directement affectée lorsque l’on se trouve atteint de cette affection, notamment sous la forme d’une baisse de la libido. Elles peuvent également se greffer et s’alimenter sur des fragilités d’ordre psychologiques présentent en arrière-plan (précarité narcissique, conduites addictives, anxiété, manque d’estime de soi, cassures familiales…).
D’une façon plus générale des problématiques d’ordre psycho-affectif peuvent avoir une incidence majeure sur le plan de la sexualité d’un sujet. Qu’elles soient d’ordre conjoncturel (difficultés relationnelles dans le couple) ou plus ancrées (blessures d’enfance, carences affectives, deuils…), elles doivent pouvoir être articulées à la spécificité de chaque trouble, comme à la singularité de l’histoire de chaque sujet.
Quoiqu'il en soit, un « trouble » sexuel en appelle certes à une parole précise, mais aussi à certains affects. Chacun pressent intuitivement que la logique du sexuel (sexo-logie) ne répond pas uniquement à des critères purement physiologiques, pouvant se réduire à une pure machinerie organique plus ou moins « performante » : le sexuel – notamment dans le trouble qu’il ne manque pas de susciter – nous renvoie à l’humain, au plus intime d’un « nous-même ». C’est ce registre – affectif, sentimental – qui d’ailleurs ne manque pas de se manifester au premier plan de la plupart des diverses affections qui viennent ponctuer le cycle normal d’une activité sexuelle. Tout simplement parce que les registres pulsionnels et affectifs sont par nature hétérogènes et entrent de ce fait en conflit (interne) l’un par rapport à l’autre. C’est « humain » certes, mais c’est également une source potentielle d’angoisse, voire de violence. A tel point que cette réalité nécessite parfois d’en passer par la parole pacifiante d’un tiers, qui saura accueillir, dans sa neutralité même, la souffrance en jeu hors de tout jugement de valeur. Et la resituer sur un mode empathique dans son contexte affectif et relationnel. Puisque telle est bien la connexion qu’il s’agit d’opérer : entre pulsion et affection, le gap prend parfois la forme d’un gouffre infranchissable. Impuissance, éjaculation précoce, frigidité, et tous les modes de sexualité compulsive ou addictive en témoignent à leur façon.
Qu’il soit objet de honte, de frustration ou de malaise, ou qu’il se pratique au contraire « sans tabous », de façon totalement « décomplexée », le sexuel est donc rarement une composante « simple et évidente » tout au long de la vie d’un couple : elle est bien plutôt régulièrement génératrice de doutes et de tensions, voire parfois de cassures au sein d’une vraie histoire d’amour ; à plus forte raison, on l’a vu, lorsque les « besoins » se manifestent de façon déconnectée de leur ancrage psycho-affectif. Ses ramifications sont complexes et profondes dans la psyché humaine, et rien n’est plus sensible que le sexuel (qui, à la base, rappelons-le, est un trouble, une authentique mise en conflit vivante et nécessaire) à cette arrière-plan « sentimental » (où se rejouent d’ailleurs les impasses de nos propres situations de dépendance antérieures).
Quelle que soit sa nature où la variété de ses formes, le « trouble sexuel » nous convoque donc à une écoute éminemment singulière, à la fois délicate et rigoureuse, des fondements même de notre « identité ». Et de son inscription dans une histoire. Qu’il s’agit précisément de faire nôtre.